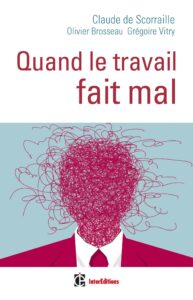La nouvelle coqueluche du langage corporate
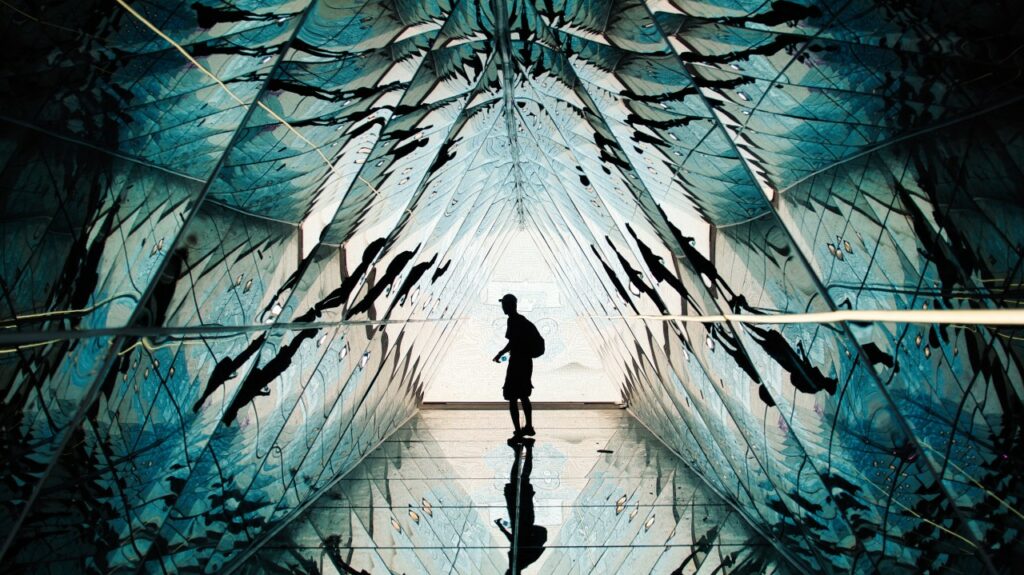
Chère lectrice, cher lecteur,
« À l’écoute », « curieux », « humain ». En relisant le CV d’un ami l’autre jour, j’ai tiqué sur un de ses soft skills. « Humain », vraiment ? À ce que je sache, aucune armada extraterrestre n’a envahi la Terre… Et pourtant, nous adorons nous distribuer des bons points « d’humanité » les uns les autres. De l’équipe « à taille humaine » au collègue « tellement humain » en passant par le « facteur humain », l’« humain » a colonisé l’étrange univers lexical de l’entreprise.
Il pourrait s’agir d’une banale lapalissade – comme lorsque Johnny Hallyday, en plein Dakar 2002, lâchait cette phrase devenue culte : « Tu te rends compte, si on n’avait pas perdu une heure et quart ? On serait là depuis une heure et quart ! »Mais il y a pour moi davantage à lire dans la soudaine popularité de cet adjectif.
En qualifiant un collègue d’« humain », nous voulons faire droit à sa singularité, en le distinguant d’une masse salariale lisse et mécanique. À travers ce terme, nous reconnaissons certaines qualités professionnelles précises : empathie, sensibilité, jovialité. Inversement, nous invoquons l’humanité en cas de manquement ou de bug : l’erreur n’est-elle pas, elle aussi, « humaine » ?
Une deuxième explication de cette épidémie d’humanité est plus conjoncturelle : c’est le facteur IA. Jour après jour, l’IA étend son rayon d’action, et le périmètre de ce qui nous semble spécifiquement humain se réduit comme une peau de chagrin. De l’écriture d’un code juridique aux Émirats arabes unis à l’élaboration de concepts philosophiques, une à une, les chasses gardées de l’humanité disparaissent. À l’instar du climat ou de la biodiversité, nous avons tendance à revaloriser ce qui nous semble menacé. C’est pourquoi nous nous replions dans les faubourgs intacts de nos vies professionnelles, ceux du travail émotionnel, collectif ou créatif, pour y resserrer les rangs de notre humanité ébranlée. Témoin de cette tendance, l’entreprise « Label Création Humaine » propose de certifier l’origine humaine de créations artistiques n’utilisant pas l’IA. L’humanité serait-elle en passe de devenir une nouvelle valeur ajoutée ?
Et c’est précisément cela qui me chagrine : nous en sommes arrivés à considérer notre vie comme potentiellement inhumaine, au point d’y ensabler quelques îlots d’humanité préservée. Si bien qu’on oublie qu’en réalité, au travail, nous sommes toujours des humains, peu importe que nous soyons en train d’envoyer le cinquantième courriel de relance de la journée, aidé ou non par une IA, de scanner un deux-millième article derrière la caisse d’un magasin, ou d’assister à une réunion stratégique.
“L’homme ne se vit pas tel qu’il se connaît et ne se connaît pas tel qu’il se vit”
— Grégori Jean, philosophe
Mais pourquoi restons-nous, à ce point, aveugles à notre humanité ? Dans L’Humanité à son insu (2020), le philosophe Grégori Jean établit une différence entre la connaissance de notre humanité et la manière dont nous la vivons. Le fait de se rapporter à notre humanité de manière réflexive, secondaire, ne peut que la dénaturer : « l’homme ne se vit pas tel qu’il se connaît et ne se connaît pas tel qu’il se vit ». Nous ne cessons de vivre dans l’ignorance de notre humanité, et c’est précisément cette ignorance qui fait le sel mystérieux de notre existence ! Le romancier Romain Gary le disait à sa manière dans Pseudo (1976) : « Plus il essayait de ne pas être un homme et plus il devenait humain ».
Et on le voit bien : quand on qualifie quelqu’un d’humain, on manque toujours notre cible, plaquant sur lui une conception générique de ce que devrait être l’humanité. Tour à tour sensible, empathique, créatif ou prompt à se tromper, l’humain que nous chérissons aujourd’hui est pris dans la toile d’attentes convenues.
Dans L’existentialisme est un humanisme (1946), le philosophe Jean-Paul Sartre critiquait déjà le renvoi systématique à une « nature humaine », où « chaque homme est un exemple particulier d’un concept universel, l’homme ». C’est la position de l’humanisme classique, « qui prend l’homme comme fin et comme valeur supérieure. […] Cet humanisme est absurde, car seul le chien ou le cheval pourraient porter un jugement d’ensemble sur l’homme ». Comprendre : aucun homme ne pourra juger l’homme de l’intérieur. « Nous ne devons pas croire qu’il y a une humanité à laquelle nous puissions rendre un culte », poursuit-il. « Le culte de l’humanité aboutit à l’humanisme fermé sur soi de [Auguste] Comte, et, il faut le dire, au fascisme. »
Pour Sartre, l’humain n’est jamais figé, il est toujours en train de se faire : « l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et […] il se définit après ». Si l’existence précède l’essence, c’est parce que l’homme, « pas définissable », « ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait ». Vous voulez faire droit à la singularité d’un collègue ? Gardez-vous de l’humaniser !
C’est tout le paradoxe de cet adjectif dont la polysémie accuse la paresse : « humain » renvoie à une soupe sémantique où barbotent des significations hétéroclites. Tant qu’une cohorte d’androïdes dopés à l’IA ne débarque pas dans vos bureaux, je suis sûr que vous ne manquerez pas d’adjectifs pour souligner l’irremplaçabilité de vos collègues. Très chers humains, il est temps de dépoussiérer vos bons vieux dictionnaires !
Un article d’Alexandre Jardin à retrouver sur le site de PHILONOMIST ici