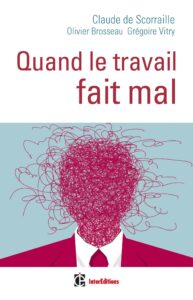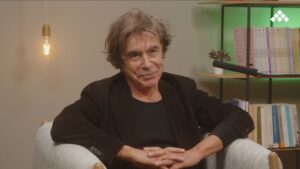Le coaching, en constante évolution, soulève autant d’enthousiasme que de questionnements. Si sa pratique se structure et se mondialise, sa compréhension théorique demeure complexe. Comment appréhender le coaching au-delà des vérités figées, en explorant ses multiples facettes et son impact sur les relations humaines?
Le coaching a connu une croissance impressionnante entre 2000 et 2010, s’imposant comme une démarche clé d’accompagnement dans le milieu organisationnel. Au fil du temps, il a pris de nombreuses formes et appellations : coaching de gestionnaires, coaching de dirigeants et de dirigeantes, coaching d’affaires, coaching de développement, coaching de redressement, ou encore, accompagnement professionnel.
Aujourd’hui, près de 15 ans plus tard, peut-on dire que le coaching a atteint une certaine maturité? Cette pratique, autrefois perçue comme relativement nouvelle, s’est progressivement installée, structurée et diversifiée. Elle s’est aussi professionnalisée sous l’influence de fédérations spécialisées qui en ont normalisé les cadres et les pratiques. Ces organismes ont établi des certifications pour les coachs et pour les formations en coaching, renforçant ainsi la crédibilité et la reconnaissance de cette discipline, dont l’évolution s’oriente même vers une supervision des superviseurs, ce qui témoigne bien de la montée en complexité de ce domaine.
Un marché en pleine explosion
Le marché du coaching continue de croître de façon spectaculaire, comme le confirment les études réalisées par des instituts certifiés, en France1 et à l’international. En 2022, selon la Fédération internationale de coaching (ICF)2, il représentait 4,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 60% depuis 2019. La moitié de ces revenus provenaient de l’Amérique du Nord, mais l’expansion géographique du coaching à l’échelle mondiale demeurait impressionnante.
Le nombre de coachs certifiés a également franchi un cap historique : en 2022, on en comptait 109 200 à travers le monde, une hausse de 54% par rapport à 2019. Parmi eux, un peu moins d’un tiers exerçaient en Amérique du Nord, reflet de la diversification croissante de cette profession dans d’autres régions du globe.
Comme tout phénomène en plein essor, le coaching suscite autant d’enthousiasme que de critiques. Le sociologue belge Nicolas Marquis évoque notamment «la religion de l’individu3», un concept qui s’étend du milieu sportif au monde scolaire. Certains critiques perçoivent le coaching comme un reflet des dynamiques sociétales et organisationnelles, à la fois symptôme et remède des dysfonctionnements en entreprise.
D’un côté, le coaching est vu comme un outil précieux pour répondre aux défis organisationnels. De l’autre, il est accusé de s’inscrire dans une logique capitaliste4 nourrie par l’industrie nord-américaine du développement personnel. Ce point de vue, porté par des philosophes, des sociologues et des psychologues, nous invite à nous interroger sur les fondements et les retombées de cette pratique.
Malgré ces positions contrastées, le coaching demeure un sujet complexe. Ses ambiguïtés peuvent être perçues autant comme des limites que comme des ressources potentielles.
Ce qu’en dit la recherche
L’examen de la littérature universitaire sur le coaching5 met en lumière une contradiction importante à considérer. D’un côté, le coaching est souvent critiqué pour son manque de bases théoriques solides. De l’autre, la diversité des cadres théoriques utilisés complique l’élaboration d’une compréhension unifiée et objective de cette pratique.
Avant même de s’attaquer aux contradictions du coaching, il est essentiel de réfléchir à la manière dont on construit nos connaissances sur cette pratique. Doit-on chercher à définir son essence, dans une démarche inspirée des philosophes grecs qui se questionnaient sur la nature des choses («qu’est-ce que c’est?») ou adopter une approche plus pragmatique? Cette dernière semble pertinente, dans un contexte où le coaching se mondialise tout en s’inscrivant dans des enjeux globaux tels que la crise écologique et les transformations numériques.
Ces constats nous invitent à repenser nos cadres de réflexion et à examiner nos biais implicites, afin d’élargir notre compréhension du coaching et de ses enjeux contemporains.
Réinventer le coaching : de l’être au vivre
Le philosophe français François Jullien propose une réflexion intéressante pour enrichir notre compréhension du coaching, en passant de la notion d’«être» à celle de «vivre»6. Selon lui, il est essentiel d’ouvrir des perspectives, notamment pour développer une vision du coaching qui reste connectée aux pratiques tout en gardant une certaine distance critique. Cela implique que l’on adopte une approche fondée sur une compréhension intelligente de la situation qui permet d’analyser le coaching dans toute sa complexité sans se limiter à des cadres théoriques figés.
Traditionnellement, la connaissance est vue comme le contraire de l’ignorance. Mais si, au lieu de la considérer ainsi, on la percevait plutôt comme quelque chose qui allie des idées à la fois complémentaires et opposées? Cette approche nous permettrait de mieux comprendre le coaching et de le voir non pas comme une vérité absolue, mais comme une pratique vivante, en constante évolution, et profondément liée à diverses situations dans lesquelles se trouvent des êtres humains. Cette idée peut sembler simple, mais elle est cruciale pour que l’on réfléchisse à la durabilité du coaching avant de chercher à imposer une vérité définitive. En effet, contredire une idée peut enrichir le débat, tandis que simplement la «contrer» ferme la discussion et empêche toute évolution.
Dans le domaine du coaching, il semble essentiel de parler de la « viabilité » de celui-ci, c’est-à-dire de son parcours et de son évolution, avant de chercher à atteindre une vérité absolue qui reste, par définition, inaccessible. En d’autres termes, au lieu de chercher à savoir «ce qu’est» le coaching de manière figée, il s’agit d’observer «ce qui se passe» réellement dans cette démarche d’accompagnement, et ce, à deux niveaux : d’une part, dans les interactions entre praticiens et chercheurs, et d’autre part, dans la relation entre le coach et le coaché.
| 10 MYTHES A DEBOULONNER SUR LE COACHING L’intelligence artificielle, notamment à l’aide d’outils comme ChatGPT, transforme notre approche de la connaissance. Il devient intéressant, voire instructif, de lui poser des questions sur des sujets complexes comme le coaching, pour découvrir les mythes qui entourent celui-ci et la réalité qui s’en dégage. Le résultat que nous vous présentons ici est étonnamment pertinent, mais il présente néanmoins des limites, notamment en termes de nuances et de compréhension contextuelle. 1 – Le coaching n’est qu’une thérapie déguisée La réalité : le coaching professionnel se concentre sur l’aide offerte à une personne pour atteindre des objectifs spécifiques et améliorer ses compétences dans un contexte de travail. Il se concentre sur l’avenir et sur les actions concrètes pour atteindre des résultats, plutôt que sur le passé et sur les problèmes émotionnels. 2 – Le coaching est réservé aux cadres supérieurs La réalité : le coaching peut être utile à tous les échelons de la hiérarchie d’une entreprise et servir tous les types de professionnels. 3 – Le coaching n’est pas nécessaire pour les personnes performantes La réalité : même les personnes performantes peuvent tirer profit du coaching pour développer de nouvelles compétences, élaborer de nouvelles stratégies ou atteindre des objectifs plus élevés et mieux relever certains défis professionnels. 4 – Le coaching est coûteux La réalité : le coût du coaching peut varier considérablement en fonction du coach et du nombre de séances. Cependant, de nombreuses entreprises considèrent qu’il s’agit d’un investissement rentable dans le développement de leurs employés. 5- Le coaching n’est pas scientifique La réalité : bien que le coaching ne repose pas sur une méthode scientifique rigoureuse, de nombreux coachs utilisent des techniques éprouvées pour aider leurs clients à atteindre leurs buts, telles que la fixation d’objectifs SMART, la visualisation positive et la méditation. 6 – Le coaching ne peut pas faire de différence significative La réalité : selon les études, le coaching peut améliorer considérablement la satisfaction professionnelle, la confiance en soi et la performance au travail. 7 – Le coaching est un processus rapide La réalité : le coaching peut mettre du temps à produire des résultats tangibles, selon les objectifs et les besoins du client. Cependant, de nombreuses personnes rapportent des améliorations significatives après seulement quelques séances de coaching. 8 – Le coaching n’est pas confidentiel La réalité : le coaching est en général confidentiel et les coachs respectent la confidentialité des clients. 9 – Le coaching ne peut pas aider en situation de crise ou de conflit La réalité : le coaching peut aider les clients à faire face à des situations difficiles en leur fournissant des outils pour gérer leur stress, résoudre les conflits et trouver des solutions à des problèmes complexes. 10 – Le coaching n’apporte pas de solution permanente La réalité : le coaching peut permettre aux clients de développer des compétences durables et leur ouvrir des perspectives qui les aideront à long terme. Cependant, il ne garantit pas de résultats durables si les personnes ne mettent pas en pratique les enseignements reçus dans leur vie quotidienne. Bien que l’intelligence artificielle ait permis de mettre en lumière ces dix mythes entourant la pratique du coaching et de décrire ce qu’on observe réellement sur le terrain, elle ne saurait rendre pleinement compte de la richesse de la dynamique humaine qui sous-tend cette approche. Au bout du compte, le coaching repose sur une rencontre vivante et profondément humaine, une interaction dont l’IA est encore incapable de saisir toute la subtilité. |
Un article de Franck Barès, Sybille Persson, Thierry Chavel à retrouver ici sur le site REVUE GESTION HEC MONTREAL à retrouver