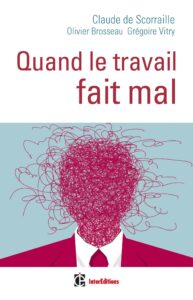C’est un mal qui touche beaucoup de gens — et dont on parle beaucoup aussi : le syndrome de l’imposteur. Ce sentiment désagréable, voire paralysant, de ne pas mériter sa place, de n’être là que par hasard, et de risquer à tout moment d’être “démasqué·e”. Pour les magazines, les réseaux sociaux, et les centaines de livres consacrés au « syndrome » ou « complexe » de l’imposteur, il est urgent de le « surmonter », de le « vaincre » ou de le « guérir ».
Mais au fond… le syndrome de l’imposteur est-il une imposture ?
D’abord, remettons les choses dans leur contexte. Le terme est né à la fin des années 70, quand deux psychologues américaines ont décrit ce ressenti chez des femmes à succès. Depuis, il a explosé dans les médias, les livres de développement personnel, les réseaux sociaux. On y voit des conseils pour “vaincre” ce syndrome comme s’il s’agissait d’une maladie. Pourtant, les créatrices du concept n’ont jamais parlé de maladie, mais d’un ressenti courant — voire normal.
Et c’est bien là que les choses se compliquent. Car derrière ce soi-disant “syndrome”, on met un peu tout. Le sentiment paralysant de ne pas être à sa place est une chose. Mais le doute à une nouvelle prise de poste, ou la modestie d’attribuer sa réussite à une part de chance, ne sont pas pathologiques. Ce flou des définitions explique que les chiffres sur la prévalence du syndrome d’imposture varient considérablement : entre 9 et 82 % de la population selon les études.
Autre problème : malgré l’image d’un malaise spécifiquement féminin, les études sont partagées, certains travaux trouvant que les femmes sont plus touchées, d’autres non. Ce qui est sûr, c’est que le syndrome est plus commenté chez les femmes. Et ça pose une autre question : pourquoi leur demande-t-on de se “soigner” de ce prétendu syndrome, au lieu de s’interroger sur l’environnement qui les fait douter ?
Car quand on doute de soi, c’est dans un contexte. Celui d’une entreprise majoritairement masculine, d’un supérieur qui doute de vos capacités, d’une culture d’entreprise qui célèbre l’assurance plus que la compétence. La personne qui se sent illégitime est peut-être avant tout une personne à qui, plus ou moins subtilement, on fait sentir qu’elle est illégitime.
Et là, on touche un point crucial : le “syndrome de l’imposteur” est peut-être, dans certains cas, une réaction normale. Imaginons une cadre qui vient d’être promue à des responsabilités importantes, et qui n’est pas sûre d’y arriver. Suf?t-il de l’encourager à surmonter son complexe de l’imposteur ? Ou a-t-elle besoin de coaching, de formation, peut-être de moyens supplémentaires ? Bref, faut-il toujours encourager celles et ceux qui doutent à “prendre confiance” ?
Parce qu’à force de valoriser la confiance en soi plus que la compétence, on finit par encourager l’image inversée du syndrome de l’imposteur : les vrais imposteurs. Vous les connaissez : ce sont ceux qui occupent de hauts postes sans en avoir les compétences, mais avec une confiance inébranlable. En général, leurs équipes les identifient très bien.
Alors, le syndrome de l’imposteur : imposture ? Pas tout à fait. Mais attention à ne pas le considérer uniquement comme un malaise individuel. C’est souvent aussi le signe d’un environnement qui ne reconnaît pas suffisamment, qui met la pression sans le soutien, qui attend la perfection mais ne l’encourage pas. Ce n’est pas toujours à l’individu de changer. Parfois, c’est à l’organisation de faire sa part.
Une vidéo a retrouver sur le site de XERFICanal